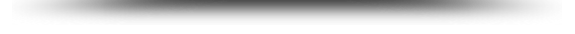ÉDITORIAL. S’il y a une dizaine d’années les chefs-d’œuvre d’anticipation du XXe siècle paraissaient sérieusement dépassés, ils redeviennent d’une actualité aussi saisissante qu’inquiétante
Le 28 avril 2025, la péninsule Ibérique sombre dans le chaos. Quelque 55 millions de personnes sont privées d’électricité: plus de métros et de trains, impossible de retirer de l’argent ou de recharger son portable, congélateurs et frigos sont à l’arrêt, laissant la marchandise se réchauffer dangereusement.
Durant une douzaine d’heures, l’Espagne et le Portugal ont vécu le tant redouté scénario du black-out. Etonnamment, il suffit d’inverser deux chiffres pour se retrouver en 2052, dans le Paris dévasté par la brutale et mystérieuse disparition de l’électricité, que René Barjavel imaginait en 1943 dans son roman Ravage.
Un livre qu’on ne peut pas analyser, près d’un siècle plus tard, sans le replacer dans son contexte historique, celui de l’occupation de la France par l’Allemagne. Au-delà de la violence dépeinte qui résonne avec la chape de plomb pesant alors sur ce pays, la défiance que lui inspire le progrès technologique et le retour à la terre qu’il préconise sont d’une actualité brûlante, tant ces deux courants émaillent des sociétés postindustrielles plongées dans le doute et l’angoisse.
L’expression de craintes plus que jamais actuelles
Bien qu’extrêmement chahuté, le monde est très loin du nouvel ordre patriarcal qui résultera de la profonde rupture provoquée par la fin de l’électricité. René Barjavel ne perçoit rien non plus de la révolution informatique qui va, quelques décennies après la publication de son livre, chambouler la vie des Terriens. Son roman d’anticipation est en revanche d’une modernité aveuglante car il nous renvoie à notre dépendance éperdue, croissante, envers cette solution énergétique.
C’est là que se trouve toute la force de cette forme de littérature qui a connu son âge d’or entre 1930 et 1950, directement inspirée des totalitarismes fasciste et communiste de cette période noire de l’Histoire. Alors que, dans la Silicon Valley, de puissantes éminences grises aspirent à une société dominée par les algorithmes, affranchie de la tutelle de l’Etat, relire Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (1931) et 1984 de George Orwell (1949) prend aujourd’hui une dimension alors inimaginable il y a une dizaine d’années.
A cet égard, ces chefs-d’œuvre dystopiques du XXe siècle sonnent aujourd’hui autant comme un puissant signal d’alarme qu’une ode désespérée à des démocraties libérales poussées dans leurs derniers retranchements.
(Re)découvrir notre série «Sous le roman, l’économie»: