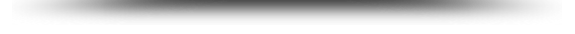CHRONIQUE. La Suisse romande soutient aujourd’hui largement la centralisation. Pourtant, elle a longtemps été un bastion d’opposition à cette tendance. Par peur d’être écrasée par la majorité alémanique, la minorité francophone refusait de donner plus de pouvoir à Berne. A raison
Né dans une famille suisse alémanique établie dans le canton de Neuchâtel, j’ai rapidement pu percevoir les différences fines, mais aussi grossières, qui existent entre les habitants des différentes régions linguistiques. Alors qu’en Romandie, le sentiment d’être dominé est exprimé, en Suisse alémanique, le ressenti le plus général envers cette communauté est une forme d’indifférence. Parfois bienveillante, et d’autre fois plus perfide, dans l’esprit de ceux qui lient Suisse romande et insignifiance.
Récemment, une polémique en lien avec l’incapacité des jeunes à apprendre la langue des autres parties du pays a fait ressortir du formol la question de notre capacité à nous comprendre. Cette interrogation n’a rien de neuf. Dans un ouvrage, le professeur Pierre Du Bois raconte qu’en 1984, L’Hebdo arrivait déjà à la conclusion suivante: «Les faits sont crus. La langue de l’autre n’attire pas. Ou n’attire plus. Le français est en perte de vitesse en Suisse alémanique. Et l’allemand n’a jamais trop plu en Suisse romande. Quant au Schwyzerdütsch, il est souvent mal considéré ou déconsidéré.» Une page plus loin, Du Bois évoque un point qui devrait bien plus intéresser la Romandie que ces sempiternels débats: «Dans l’administration centrale, toutes les langues sont égales. Mais l’allemand est de loin la plus égale de toutes.»
Voir plus