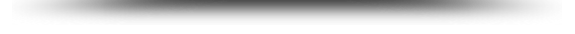Les aventures du héros de Daniel Defoe ont inspiré nombre d’économistes, dont Marx et Turgot, au point d’en faire un concept: la robinsonnade. C’est l’unique roman à jouir d’une entrée dans le dictionnaire de référence de la science économique
Un homme se retrouve seul sur une île déserte, unique rescapé d’un naufrage. A l’aide d’un radeau de fortune, il parvient à extraire du navire éventré par les récifs des denrées de base, des armes et quelques outils. Rapidement, il s’accommode de son sort et s’emploie à améliorer son existence. Il dispose de sa volonté et surtout d’un temps infini – sa solitude durera vingt-quatre ans, son séjour vingt-huit.
Cet homme, c’est bien sûr Robinson Crusoé. Personnage principal du roman du même nom publié en 1719, il est devenu un concept: la robinsonnade. Comment subvient-il à ses besoins? Quel rapport entretient-il à son environnement? Son travail est-il uniquement utilitaire? Dans quelle mesure la solitude modifie-t-elle sa prise de décision? Toutes ces questions jaillissent et expliquent pourquoi Robinson Crusoé est certainement l’unique œuvre littéraire jouissant d’une entrée dans le New Palgrave, dictionnaire économique de référence, relève Claire Pignol, maîtresse de conférences en économie à la Sorbonne dans un article sur les «usages et mésusages d’un roman».
Voir plus